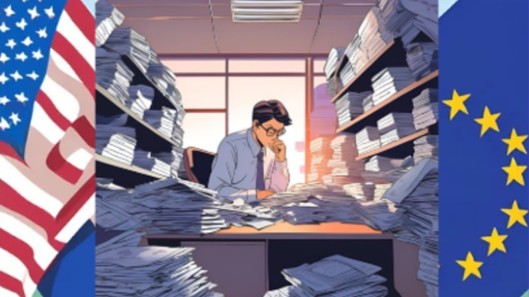Les élections américaines et le retour tonitruant de Donald Trump au pouvoir ne font qu’accentuer un climat déjà délétère en Europe qui prend sa source avec le Brexit en 2016. Cependant, les racines du mal remontent bien plus loin.
Ces dernières années, l’Europe a enchaîné les crises :
- Politiques : Gouvernements difficiles à constituer (Belgique, France, Espagne, Allemagne…) et qui ont perdu la confiance des citoyens,
- Économiques : Érosion continue du pouvoir d’achat et explosion des déficits publics,
- Géopolitiques : Tensions internationales vis-à-vis desquelles l’Europe joue les seconds rôles,
Ce « déclassement » se remarque dans la vie quotidienne et nous rappelle à quel point notre continent perd pied chaque jour un peu plus. Certes, les écarts de croissance avec les autres puissances économiques semblent assez modestes lorsque nous les observons année après année sans mesurer l’écart consolidé. Les Etats-Unis vont vraisemblablement conclure l’année 2024 sur une croissance de 2.7%, la Chine devrait enregistrer 5% et l’Europe 0.7%. L’écart avec les Etats-Unis n’est « que » de 2%, ce qui parait presque anecdotique. Mais la composition d’un tel écart sur une longue période engendre pour nous un appauvrissement significatif. A titre d’illustration, si la différence pointée en 2024 reste constante pendant 10 ans, cela représentera alors une croissance cumulée de 7.2% pour l’Europe quand les Etats-Unis afficheront 30.5% et la Chine 62.9%… C’est justement ce que nous observons depuis, non pas 10 ans, mais plus de 20 ans et qui marque le véritable déclassement de l’Europe.
D’où proviennent ces écarts de croissance ?
Flexibilité du travail et protection sociale
Les années de la Mondialisation, à travers le gigantesque transfert de richesses des pays les plus prospères – l’Occident – vers ceux qui étaient encore « en voie de développement » au siècle dernier, ont rebattu les cartes du coût du travail, ce que l’UE s’est obstinée à nier. En Amérique du Nord, la « protection » des employés est plus faible qu’en Europe. Les coûts de licenciement sont dérisoires, les contraintes administratives et les obligations légales pour les sociétés restent beaucoup plus légères. Selon la plupart des économistes libéraux, cela favorise l’adaptabilité des entreprises lors de chocs économiques. Mais pas seulement, en effet, hors crise économique, cette flexibilité permet également aux sociétés productrices et commerciales d’adapter bien plus rapidement leurs stratégies. Elle rend ainsi les entreprises plus agiles et plus efficaces. Avec une organisation du travail construite sur la défense et la protection de droits acquis, le modèle social Européen est devenu réactionnaire car, bâti sur la perpétuation de l’existant, il s’est rendu imperméable aux révolutions induites par l’explosion du commerce et les mutations technologiques. Le modèle européen qui protège les citoyens en période de crise, sclérose l’économie et limite les incitations à la prise de risque. Le choix entre « stabilité » sociale et dynamisme économique reste un dilemme fondamental pour l’Europe.
De même, le modèle social de nos gouvernements européens implique des niveaux de dépenses publiques (santé, éducation, retraites, chômage…) très généreux. La part du PIB ainsi transféré améliore sensiblement la qualité de vie de nos concitoyens mais limite fortement l’investissement dans les secteurs stratégiques et la réduction des dettes et des déficits. De plus, ces dépenses impliquent nécessairement des taux d’impositions plus élevés pour les ménages, grevant d’autant leur pouvoir d’achat. Dans le même effort de redistribution, les impôts des sociétés demeurent plus élevés confisquant de la valeur sur les rémunérations des salariés, les investissements mis en place ou encore les distributions accordées aux actionnaires.
Cette volonté de réduction des inégalités sociales au travers de systèmes sociaux robustes pèse ainsi sur la croissance économique. Les détracteurs rappellent que ce modèle social devient tellement lourd à porter qu’il finit par appauvrir toute la zone euro et décourage l’initiative économique qui profiterait à tous ; en bref, un véritable nivellement par le bas en nourrissant au passage une forme de sous-emploi déguisé. Ils argumentent également que ce système n’est pas tenable à long terme. Quant aux défenseurs du modèle, ils rappellent que chaque crise est amortie permettant notamment aux entreprises privées de ne pas sombrer grâce à des consommateurs soutenus par ces programmes sociaux.
La culture comme support
Des aspects culturels impactent également nos manières de concevoir l’économie.
Aux États-Unis, l’échec fait partie du parcours entrepreneurial classique. L’accès au capital est facilité, et l’esprit pionnier valorise la prise de risque. Un entrepreneur peut ainsi faire valoir son droit à bénéficier d’une protection plus ou moins comparable à celle mise en place lors des faillites de sociétés. Cette règle représente un énorme encouragement à la prise de risque des entrepreneurs. Celui qui aura échoué, en limitant le coût de son échec, ne sera pas pénalisé dans son avenir et pourra entreprendre à nouveau.
En Europe, seuls les pays du Nord (impact de la tradition protestante ?) partagent cette approche anglo-saxonne. Le reste du continent est davantage dans une logique de protection des individus. L’échec n’est plus vraiment toléré et les entrepreneurs qui subissent des difficultés sont, de surcroît, trop souvent stigmatisés. Une faillite pouvant entrainer des répercussions durant toute une vie, seuls les entrepreneurs les plus tenaces se lancent dans la création d’entreprises. Il en résulte naturellement un manque d’innovation, notamment dans les nouvelles technologies, qui incarnent par essence le moteur de la création de richesse et la force de disruption de nos modèles établis. Aux États-Unis, c’est cette culture de l’innovation qui favorise l’émergence d’un écosystème dynamique, porté par des leaders mondiaux, soutenu par des universités d’excellence et alimenté par des investissements massifs en R&D.
La culture européenne, où la réussite est moins encouragée, la notion d’argent plutôt taboue et la réussite peu ostentatoire, la protection sociale exacerbée et l’individu déresponsabilisé, entraine une approche « quelque peu » différente vis-à-vis de l’investissement.
Les Flux financiers
La culture américaine favorise également le financement des projets. En effet, les Américains ont compris depuis longtemps que, pour entreprendre, il fallait non seulement de la main d’œuvre mais aussi du capital. Au grand dam des sociétés socialistes, l’un ne va malheureusement pas sans l’autre. Même le parti communiste Chinois l’a compris et mobilise des capitaux énormes pour ne pas se pas perdre la compétition industrielle qui fait rage. Les développements dans l’Intelligence Artificielle montrent aussi à quel point les flux de capitaux sont primordiaux. L’Europe possède, au même titre que les Etats-Unis et la Chine, d’excellents ingénieurs capables d’innover. Malheureusement, les projets de nos « cerveaux » trouvent plus facilement des financements à l’étranger qu’en Europe. Ceci entraine une véritable hémorragie du capital humain. Pire, de nombreux investisseurs européens qui désireraient placer une partie de leur capital dans l’innovation sont refroidis par les contraintes réglementaires et les lourdeurs administratives et fiscales. L’Europe est devenue un système étatique auto-entretenu ou les gouvernements pallient les insuffisances de l’investissement privé à travers des subventions et des aides, elles-mêmes financées par les impôts des citoyens… Pourtant, l’épargne privée, prise dans son ensemble, dépasserait largement les capacités budgétaires publiques. Il est donc navrant de constater l’énorme sous-utilisation de capitaux générée par l’aberration bureaucratique européenne. La libération de cette épargne publique devient urgente, pour la compétitivité de notre zone économique, l’emploi, et la prospérité de nos citoyens.
La règlementation
Mantra de la nouvelle équipe au pouvoir aux Etats-Unis, la règlementation constitue bien évidemment un frein à l’innovation et à la création d’entreprises. Cet axe, déjà très différent entre Européens et Américains, prend, en effet, une tournure encore plus marquée depuis l’arrivée de Donald Trump au pouvoir. Le corolaire reste la protection des particuliers et des entreprises, mais là encore, le curseur correspond aux choix politiques et sociétaux. Le système financier européen repose sur des critères stricts et conservateurs visant à éviter que des situations comme la crise de 2008 ne se répète. La mobilisation des flux financiers ainsi que les leviers opérés en pâtissent forcément. Mais ces choix règlementaires ne se limitent malheureusement pas à la sphère financière : tous les pans de l’économie des pays de l’Union sont touchés et les pertes de compétitivités deviennent flagrantes. Une administration tatillonne régente toute l’organisation de nos vies. Pour faire écho au virage pris par les Etats-Unis, de nombreuses voix s’élèvent pour demander avec raison un moratoire règlementaire. Mais, si l’Europe veut avoir une chance de revenir dans la course, il faudrait parler d’« allègement » des règlementations plutôt que de « moratoire ». La réglementation est un débat sans fin, où l’équilibre entre sécurité et dynamisme économique reste un défi permanent qu’il est difficile de trancher. Une chose est sûre : aujourd’hui, rares sont ceux qui défendent encore l’approche rigide imposée ces dernières années par les instances européennes, dont l’excès de normes a freiné la compétitivité et l’innovation. Pas plus tard que la semaine dernière, nos dirigeants prenant conscience du fait que nous sommes allez trop loin, proposaient une boussole pour donner un nouveau cap. Là encore, nous excellons en images chocs et présentations « marketing ». C’est de pragmatisme dont nous avons cruellement besoin et non de phrases choc. Mais ne nous trompons pas, s’il s’agit de révolutionner nos contraintes règlementaires, il ne faut pas non plus tomber dans l’excès inverse et jeter à mal toutes les règles. Bon nombre d’entre elles organisent nos vies quotidiennes pour éviter le chaos. La plus grande difficulté pour nos régulateurs/politiques, est de trouver le bon positionnement entre un minimum de sécurité et une libération des énergies productives. L’Europe est allé trop loin, il s’agit maintenant de trouver le bon réglage.
Un adage commence à circuler depuis quelques années : c’est lorsque l’Europe est en crise qu’elle progresse. Bonne nouvelle !! L’Europe est en crise !!!